- Source : Ademe
Le préambule de l'Accord de Paris de 2015 souligne les « impératifs d'une transition juste pour la population active »(1). Ce concept est de plus en plus employé, y compris dans les réglementations (comme le mécanisme pour une transition juste dans l'UE(2)), dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique et des profondes mutations associées, en particulier dans le secteur énergétique.
L'Ademe (Agence de la Transition écologique) consacre l'avis ci-après à la transition « juste » en rappelant qu'il y a « beaucoup plus à perdre qu’à gagner à l’inaction climatique en France et dans le monde ».
Qu'est-ce qu'une transition « juste » ?
Quand est apparu ce concept ?
Selon les Nations unies(3), le concept de transition énergétique est apparu dans les années 1980 aux États-Unis : il était alors utilisé par les syndicats américains défendant les intérêts des travailleurs impactés par les nouvelles réglementations sur les pollutions de l'air et de l'eau.
L'Ademe, qui évoque quant à elle l'usage de ce terme à partir de 1993 par les syndicats aux États-Unis, précise qu'il est, avant sa mention dans l'accord de Paris, inscrit dès 2010 dans l'accord final de la COP16. Lors de la COP24, la transition juste a fait l'objet d'une déclaration spécifique dite « Déclaration de Silésie sur la solidarité et la transition juste »
Définition aujourd'hui
Pour l'Ademe, « l’idée de transition juste est née du refus de légitimer l’inaction en matière environnementale au nom des pertes d’emploi qui découleraient des politiques mises en œuvre ».
Parce que la transition vers un système moins émetteur de CO2 (du « brun » au « vert » selon les termes de l'Ademe) relève de l'intérêt général, elle doit s'accompagner de mesures pour aider « ceux qui vont y perdre en termes d’emploi ou d’actifs matériels et financiers, qu’il s’agisse de ménages, d’entreprises ou de territoires », autrement dit les « perdants » de la transition.
L'importance d'une transition « juste » a entre autres été mise en exergue par le mouvement des Gilets jaunes appelant à concilier « fin du monde » et « fin du mois ».
Définition de la transition juste par l'Organisation internationale du travail (OIT)
Comment assurer une transition juste ?
Impacts financiers et sur l'emploi
La transition doit s'accompagner de « mesures qui peuvent être économiques, sociales, commerciales », souligne l'Ademe. L'Agence rappelle que la transition, bien que son bilan global sur l'emploi soit « légèrement positif » selon ses prévisions, va engendrer de grands bouleversements dans certains secteurs.
Ainsi, 10 000 emplois pourraient notamment être perdus dans l'industrie automobile en France entre 2021 et 2026 en raison du développement de l'électromobilité, en l’absence d’un plan de relocalisation, indique l'Ademe.
La transition énergétique conduit par ailleurs à dévaloriser certains actifs physiques et financiers liées aux activités « brunes » (et à réduire certaines recettes fiscales pour l'État, par exemple de l'ordre de 13 milliards d'euros par an à l'horizon 2030 en raison du basculement des voitures thermiques vers l'électromobilité).
Des dédommagements peuvent alors être apportés, comme cela a notamment été demandé par l'Équateur pour préserver la biodiversité du Yasuni, rappelle l'Ademe.
Participation du public
La transition ne peut, selon l'Agence, être juste qu'avec « la participation le plus large possible de l’ensemble des parties prenantes, citoyens compris pour décider, élaborer, prioriser les actions et opérer les arbitrages ».
Or, près de 64% des Français estiment que le système démocratique fonctionne plutôt mal en France et que leurs idées ne sont pas bien représentées, rappelle l'Ademe. Fake news ou discours complotistes compliquent encore les conditions d'un échange constructif.
« Il s’agit ici de permettre aux citoyens de solliciter les experts voire d’orienter la production scientifique pour répondre à leurs préoccupations », ce dialogue science/société devant entre autres être rendu possible dans le cadre de la Commission nationale du débat public.
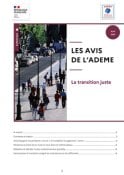
Sources / Notes
- Accord de Paris.
- Le mécanisme pour une transition juste: pour que personne ne soit laissé pour compte, Commission européenne.
- Qu’est-ce que la transition juste ? Et pourquoi est-ce important ?, Nations unies, 8 décembre 2022.
Quatre idées reçues sur la « transition juste », The Transition, 15 mai 2024.





