- Source : Yvan Cliche
À la suite de l’échec de ses dernières interventions armées (Afghanistan, Irak), les États-Unis ont troqué la force militaire pour des pressions économiques, des sanctions, pour contraindre leurs ennemis et exercer leur puissance, explique Edward Fishman. Ce chercheur de l’université Columbia est bien placé pour parler du sujet : M. Fishman est en effet un ancien haut fonctionnaire (Pentagone, département d’État, Trésor), qui a participé directement à l’élaboration de cet arsenal de sanctions, devenu un axe majeur de la politique étrangère américaine.
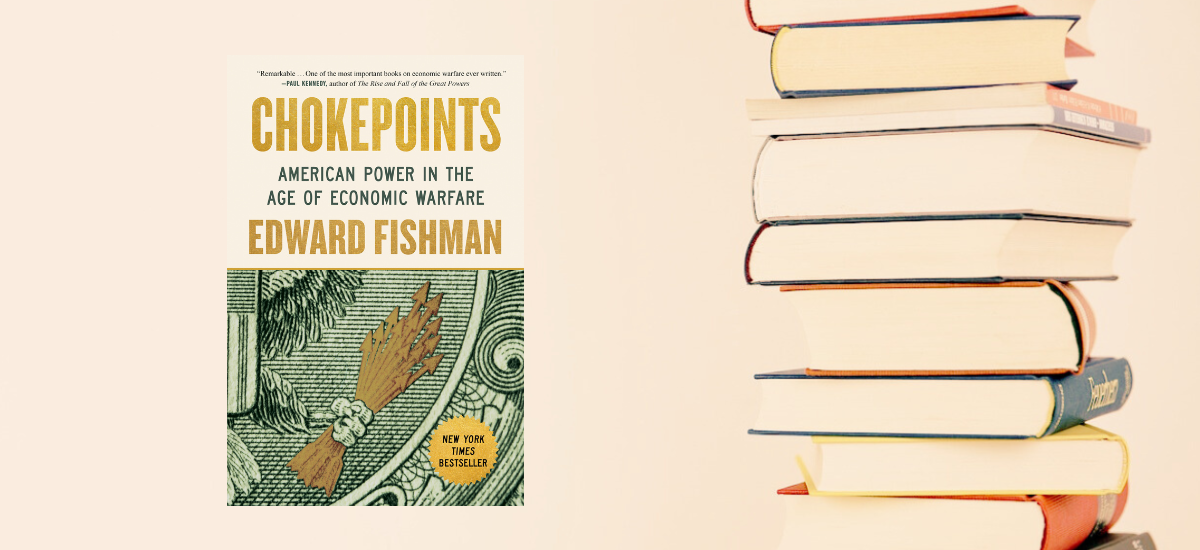
Une influence liée directement au poids du dollar dans l’économie
Le livre capte l’attention dès les premières pages. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, quelques paragraphes à caractère réglementaire, émis en mars de la même année par le Trésor américain, suffisent pour interrompre le trafic maritime dans le détroit du Bosphore. Selon ces nouvelles règles, aucune entreprise américaine ou européenne ne peut transporter, assurer ou financer le pétrole russe au-delà d’une limite établie à 60 $ USD le baril. Ceci afin de limiter les revenus de la Russie servant à soutenir son effort de guerre en Ukraine.
Des règlements émis à Washington, souligne Fishman, mais qui ont un effet immédiat, et qui contribuent à reconfigurer sensiblement le commerce physique du pétrole. « Les pressions économiques existent depuis des siècles, mais au cours des deux dernières décennies, leur sophistication et leur impact ont progressé à pas de géant. Dans une économie mondiale interconnectée par un demi-siècle de mondialisation et de réformes néolibérales, les actions des responsables américains peuvent envoyer des ondes de choc à travers le monde à une vitesse stupéfiante », analyse-t-il.
Cette nouvelle forme d’influence, rendue possible par la mondialisation des chaînes d’approvisionnement, repose sur la suprématie américaine dans les domaines de la finance internationale et des technologies. La primauté financière s’est construite autour du rôle central du dollar dans la mondialisation du marché pétrolier, l’or noir étant devenu le moteur de l’économie mondiale. C’est là que prend forme la domination du dollar des États-Unis dans les transactions à l’échelle internationale.
Le dollar est impliqué dans 90 % des transactions à l’échelle planétaire, note Fishman. Les banques centrales détiennent des réserves majoritairement en dollars (environ 60%), et près de 70% des dettes étrangères mondiales sont libellées dans cette même monnaie. « Tenter de naviguer dans l'économie mondiale sans accès au dollar, c’est comme essayer de voyager dans le monde sans passeport [...] L’importance du dollar dans l’économie mondiale donne aux États-Unis le contrôle d’un point d’étranglement (chokepoint, NDLR) d’une valeur stratégique inégalée. »
À cette domination financière s’ajoute celle des technologies numériques (Internet, bases de données, serveurs), secteur également dominé par les États-Unis. Grâce à cette double hégémonie – financière et technologique – les États-Unis sont désormais capables de contraindre des États adverses selon les préceptes de Sun Tzu : soumettre l’ennemi sans livrer combat. Les guerres traditionnelles – terrestres, aériennes ou navales – deviennent presque obsolètes.
Une « guérilla en complets gris »
Sur le plan bureaucratique, cette « guérilla menée en complets gris » selon l’expression de l’auteur, est dirigée principalement par le département du Trésor, en concertation avec le département d’État, le ministère des Affaires extérieures des États-Unis.
Une des premières cibles de cette stratégie inaugurée dans la décennie 2010 : l’Iran. Plutôt que de bombarder ses installations nucléaires, les États-Unis préfèrent cibler l’économie iranienne, et particulièrement son secteur pétrolier, en restreignant progressivement son accès au système financier international, indispensable pour engranger les revenus d’exportation. « Perdre l’accès au dollar, c’était une condamnation à mort pour toute entreprise ayant une vocation mondiale, de sorte que la simple menace de sanctions suffisait à dissuader », écrit Fishman. « Un des enjeux a été de faire comprendre aux pays le sérieux de cette approche américaine ».
La Russie sera également dans le collimateur des sanctions américaines, d’abord après l’annexion de la Crimée en 2014, puis après l’invasion de l’Ukraine en 2022. « Les sanctions économiques sont devenues une force puissante au service d’objectifs de politique étrangère clairs et coordonnés – un pouvoir intelligent pour les situations où la diplomatie seule est insuffisante, mais où la force militaire ne constitue pas la bonne réponse ».
Comme on le voit, ces guerres économiques sont souvent menées contre des pays pétroliers (Venezuela, Iran, Russie) : on note tout au long du récit combien les responsables des sanctions resteront éminemment soucieux d’éviter que celles-ci enflamment les prix à la pompe et nuisent à la popularité du Président.
Endiguer la montée de la Chine
Autre cible majeure de Washington, surtout depuis la première présidence Trump : la Chine. Des responsables américains, Républicains comme Démocrates, estiment que ce pays a abusé de son intégration à l’économie mondiale en profitant du système mais sans en respecter les règles, ni évoluer vers une gouvernance fondée sur l’État de droit. Beaucoup regrettent que les États-Unis aient permis l’ascension de la Chine sans agir plus tôt pour inverser la tendance.
« L’interdépendance économique a effectivement rendu le monde plus riche. Mais elle n’a jamais prouvé qu’elle pouvait le rendre plus sûr », observe Fishman. Il ajoute : « Le monde perdra l’efficacité et les prix bas permis par cette interdépendance, mais il y gagnera un sentiment de sécurité […] Le monde deviendra divisé en blocs économiques, mais sera en paix ». Fishman prophétise que « la course à l’armement économique s’intensifiera probablement dans les années à venir ». Ces guerres sont devenues un axe majeur du rapport de force entre les États et les puissances d’aujourd’hui et de demain.
Cependant, avertit-il, cette domination – cette militarisation du dollar – comporte un revers. Face à cette nouvelle forme de pression, les économies nationales chercheront de plus en plus à protéger leur souveraineté. « Le plus grand risque (des sanctions) est celui de la “surutilisation” », écrit-il. Les gouvernements ne resteront pas effectivement les mains croisées. Si on suit Fishman, les gouvernements devraient tenter, dans les prochaines années, d’atténuer les aspects de la mondialisation qui les rendent vulnérables à des sanctions américaines.
Ils devront déployer une stratégie pour se dissocier des effets potentiellement délétères de leur intégration économique dans une économie internationale dominée par le dollar ; et une autre pour se distancier, autant que faire se peut, de l’emprise des technologies américaines soutenant le développement accéléré d’une économie numérique mondialisée.
« Chokepoints - American Power in the Age of Economic Warfare », Edward Fishman (Penguin Random House)
Commentaire de lecture par Yvan Cliche, fellow, Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM), auteur de Jusqu’à plus soif-Enjeux et conflits énergétiques (Fides, 2022).




