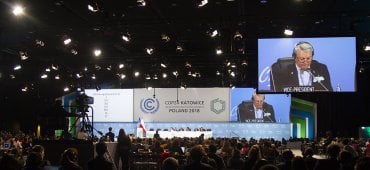Professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine - PSL
Fondateur de la Chaire Économie du Climat
Depuis 1990, l’océan a absorbé 26% des émissions anthropiques de CO2 et la biosphère 30%, le reste s’accumulant dans l’atmosphère. Sans l’action de ces puits, la croissance du stock de CO2 atmosphérique aurait été bien plus rapide. Pour que les baisses d’émissions conduisent à la neutralité carbone, il est crucial qu’océan et biosphère continuent de retirer le CO2 de l’atmosphère.
Les impacts anthropiques sur les puits de carbone terrestres comme la déforestation ou la reforestation ont été intégrés dans la négociation climatique dès les années 1990. Ce n’est pas le cas de l’océan qui reste l’angle mort des politiques climatiques. La troisième conférence de l’ONU sur l’océan (UNOC) se tient à Nice du 9 au 13 juin. Peut-elle déplacer les lignes ? Un enjeu majeur, comme le soulignent les deux articles publiés sur notre blog à cette occasion.
La chasse à la loutre de mer ou l’économie de prédation
Présente le long des côtes du Pacifique Nord, la loutre de mer est le plus petit mammifère marin. Contrairement à ses congénères vivant dans les eaux froides, elle ne dispose pas d’une épaisse couche de graisse facilitant sa régulation thermique. Elle est protégée du froid par l’un des pelages les plus denses du règne animal. L’intérêt économique de sa fourrure a bien failli causer son extinction.
Les trappeurs commencèrent à exploiter commercialement le filon dès le début du XVIIIe siècle en traquant l’animal le long des côtes russes. Les fourrures étaient écoulées en Chine et en Europe. L’activité changea d’échelle après 1850, avec la cotation des fourrures sur le marché des matières premières de Londres, qui devint la plaque tournante du commerce international. L’offre peinant à suivre la demande, la hausse du prix des fourrures incita au déplacement des aires de capture vers l’est. Le détroit de Behring fut franchi. Les côtes de l’Alaska faisant à leur tour l’objet d’une surexploitation, les volumes s’effondrèrent. Une division par dix des volumes traités sur le marché de Londres entre 1885 et 1900. La pénurie d’offre attisant l’envolée des cours, les trappeurs commencèrent à s’attaquer à des stocks encore plus fragiles en descendant le long du Pacifique jusqu’en Californie.
En déplaçant les aires de capture à mesure de l’épuisement des stocks d’animaux, on se dirigeait vers une extinction totale de l’espèce. Pour éviter l’effondrement final, un traité international, le North Pacific Fur Seal Convention, fut signé en 1911 entre la Russie, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni (pour le compte du Canada) prohibant la traque de l’animal. Ce fut l’un des premiers traités internationaux de protection de l’environnement qui sauva probablement l’espèce, alors ramenée à moins de deux mille survivants.
On estime aujourd’hui la population de loutres de mer entre cent et cent cinquante mille individus, soit les deux tiers de sa population d’avant la grande prédation. L’espèce est encore soumise à des prédations humaines (braconnage, prises accidentelles dans les filets de pêche, marées noires et pollutions côtières) et animales (en particulier les orques et les requins blancs). Certaines populations, notamment dans l’archipel aléoutien, au large de l’Alaska, subissent à nouveau un déclin.
Une alliée pour protéger le puits de carbone océanique
Pour maintenir sa température corporelle à 35 °C dans des eaux froides, la loutre de mer ingurgite quotidiennement jusqu’au quart de son poids. Carnivore, elle se nourrit principalement de petits crustacés, d’étoiles de mer et surtout d’oursins. L’oursin est un gros mangeur d’algues. Sitôt que la loutre disparaît, il prolifère au détriment des ressources en algues.
La présence de la loutre accroît d’un facteur douze la capacité de stockage du CO2 de ces écosystèmes marins.
Par ses prédations, la loutre exerce un rôle régulateur sur la population d’oursins et protège les kelps, ces forêts de varech sous-marines dont est friand l’oursin. Or, ces forêts stockent de grandes quantités de CO2. Les chercheurs de l’université de Californie ont estimé que la présence de la loutre accroît d’un facteur douze la capacité de stockage du CO2 de ces écosystèmes marins. La loutre de mer est donc un allié précieux pour protéger ou renforcer l’action du puits de carbone océanique.
La régulation de la population d’oursins par celle des loutres illustre un mécanisme que les chercheurs appellent les cascades trophiques. Le phénomène a été décrit dès 1949 par l’écologue américain Aldo Leopold, qui observa la prolifération de la population des cerfs, un autre herbivore, à la suite de l’élimination du loup, son prédateur naturel. Dans le milieu naturel, la régulation d’une population résulte de multiples interactions, souvent liées aux ressources accessibles (nourriture, habitat…). Mais il faut compter avec ses prédateurs. Les cascades trophiques révèlent le rôle des carnivores à l’amont des chaînes alimentaires dans la régulation des populations d’herbivores vivant sur les continents, ou dans les océans à l’instar de l’oursin. Ce mécanisme peut avoir un impact sur la capacité de la nature à stocker le CO2 de l’atmosphère, comme l’explique Oswald J. Schmitz dans son ouvrage The New Ecology.
La prolifération d’oursins consécutive au déclin de la loutre de mer altère localement le fonctionnement de la pompe à carbone océanique. Protéger la loutre est donc une action qui se justifie, au-delà de la valeur qu’on peut donner à telle ou telle espèce, par l’objectif climatique. Le long de la côte de Colombie-Britannique, dans l’Ouest canadien, la réimplantation de la loutre a été un succès. La restauration des kelps permet à l’écosystème côtier de stocker chaque année l’équivalent de 6 à 10% des émissions de CO2 de la province.
L’océan, angle mort des politiques climatiques
Mais ce bénéfice climatique n’apparaît nulle part dans l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre que le Canada doit établir chaque année et soumettre aux Nations unies dans le cadre de l’accord de Paris.
Dans les COP climat, lorsque les pays rendent compte de leur contribution à l’accord de Paris, ils comptabilisent les émissions ou absorptions de carbone résultant des modes d’utilisation des terres. Aucun n’est redevable de ses impacts sur l’océan où est pourtant stocké le plus grand réservoir de carbone de la planète : la biosphère terrestre stocke l’équivalent de 4 fois la quantité de CO2 présente dans l’atmosphère. L’océan en stocke l’équivalent de pratiquement 50 fois !
Ce trou dans la raquette est souvent justifié par le caractère extraterritorial de l’océan ou l’insuffisante connaissance de son fonctionnement. Des justificatifs à bon compte.
Le fonctionnement du puits de carbone océanique
Le fonctionnement du puits de carbone océanique est particulièrement complexe. On peut le schématiser ainsi : le CO2 est dilué en surface dans les eaux de l’océan. Une partie de ce carbone est transférée vers les fonds marins, où il sera stocké pour longtemps sous forme de sédiments. Le transfert de la surface vers le fond s’opère grâce à la biodiversité marine. Les phytoplanctons, des microalgues utilisant la photosynthèse dans la partie lumineuse de l’océan pour leur croissance, jouent un rôle prépondérant dans le fonctionnement de cette pompe à carbone biologique.
La capacité de stockage du CO2 par l’océan est en premier lieu susceptible d’être altérée par l’impact du réchauffement climatique. En surface, le CO2 est dissous par des mécanismes physiques tributaires de la température de l’eau. Les eaux froides absorbent le carbone atmosphérique que les eaux chaudes rejettent. Le réchauffement global risque de perturber ce mécanisme en même temps qu’il provoque l’acidification de l’eau.
Le fonctionnement de la pompe biologique est également susceptible d’être altéré. Sitôt que la température de l’eau augmente, les coraux blanchissent et les barrières coralliennes sont affaiblies. Les records de température océaniques ont ainsi déclenché en 2024 un épisode mondial de blanchissement d’une ampleur sans précédent, affectant aussi bien la grande barrière australienne que les massifs situés en mer Rouge ou dans les Caraïbes.
Mais ces écosystèmes côtiers ne constituent qu’un échantillon de taille minuscule comparé à l’immensité de l’océan. L’affaiblissement potentiel du puits de carbone océanique est difficile à modéliser en raison de nombreuses incertitudes, « la plus importante étant la réponse du vivant au changement climatique », suivant l’expression de l’océanographe Laurent Bopp et de ses coauteurs dans leur note scientifique accessible sur la plate-forme Océan et climat(1).
Les atteintes au puits de carbone océanique
À l’impact du réchauffement sur le fonctionnement du puits de carbone, s’ajoutent ceux résultant de l’activité humaine. La protection de la loutre marine illustre une pratique bénéfique en termes de stockage de carbone par l’océan, mais qui ne fait que corriger une prédation anthropique antérieure. D’autres pratiques humaines peuvent jouer positivement. La conchyliculture a par exemple un effet bénéfique car la coquille de l’huître ou de la moule piège du carbone. Cet effet disparaît si, en fin de cycle, ces coquilles sont incinérées par mégarde avec d’autres déchets. Il en va de même de protection des herbiers marins qui contribue à l’absorption de « carbone bleu ». À plus grande échelle, certains imaginent demain des méthodes de type industriel permettant de stimuler la production de phytoplanctons grâce à la fertilisation de l’océan ou de contrer son acidification via son alcalinisation artificielle.
Dans certains cas, impacts anthropiques et climatiques peuvent s’additionner. Le krill de l’Antarctique, l’espèce pélagique la plus abondante de la planète, est ainsi doublement menacé par la surpêche industrielle et le réchauffement des eaux océaniques nuisible à sa reproduction. Or, les krills séquestrent chaque année autant de carbone sous forme de sédiments au fond de l’océan (300 Mt de CO2) que la totalité du « carbone bleu » absorbé par les herbiers marins, les marais salés et les mangroves dans le monde.
D’après l’IPBES, la surpêche est la première cause de dégradation de la biodiversité marine. La surexploitation de la loutre marine ou celle du krill antarctique en fournissent deux illustrations. Il reste beaucoup d’autres cas à documenter pour analyser les impacts de la surpêche sur la composition de cette biodiversité et diagnostiquer leurs incidences sur la capacité de séquestration du carbone par les océans.
L’un d’entre eux est désormais établi. Le chalutage des fonds marins provoque probablement une quantité de CO2 relâchée de l’ordre de 1,5 Gt par an. Le raclage du sous-sol agit de façon similaire au labour en surface. Il libère une partie du carbone qui était séquestré dans le sol au fond de l’eau. Sous l’angle du cycle du carbone, la disparition d’une forêt d’algues sous-marines est l’équivalent de la déforestation sur Terre et le chalutage des fonds, celui d’un labour profond.
L’empreinte climat de la déforestation et des labours est répertoriée dans les inventaires de gaz à effet de serre, malgré les nombreuses difficultés méthodologiques. En dépit de ces difficultés, il serait possible d’y intégrer l’impact des pratiques de pêche et des autres activités affectant le puits de carbone océanique. Les méfaits de la pêche et du déversement des polluants seraient comptabilisés en émission. Les bénéfices apportés par la protection de la loutre marine ou celle de la grande barrière de corail, le plus vase herbier marin de la planète, seraient comptés en absorptions.
Un enjeu de justice climatique
Pour sortir de « l’angle mort » des politiques climatiques, il faudrait en premier lieu exiger que les impacts de l’activité humaine sur l’océan, positifs ou négatifs, soient correctement comptabilisés dans les inventaires nationaux de gaz à effet de serre à partir desquels sont pris les engagements des États dans le cadre de l’accord de Paris, les fameuses « contributions nationales déterminées ».
Un argument avancé pour justifier la non-prise en compte de l’océan dans les politiques climatiques est le caractère territorial des inventaires de gaz à effet de serre qui servent au suivi des engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris. Ici encore, l’argument est trompeur.
En droit international, chaque pays est responsable, depuis la convention des Nations unies de Montego Bay (1982), de la gestion de la pêche dans les « zones économiques exclusives ». Ces zones ne recouvrent que le tiers de la surface de l’océan, mais 90% des ressources halieutiques et des activités de pêche. Les États sont donc redevables des atteintes que l’activité humaine est susceptible de porter sur cette partie du puits océanique.
Pour la partie de haute mer, ce bien commun aujourd’hui si mal protégé, ce pourrait être le rôle de l’Organisation maritime internationale, comme elle est déjà censée le faire pour les émissions de carbone fossile rejeté par les navires, ou de tout autre organisme impartial affilié aux Nations Unies.
Derrière les mauvais prétextes justifiant la non-intégration du puits de carbone océanique dans les politiques climatiques se cachent également les intérêts économiques de la pêche industrielle et des pays la pratiquant. En absence de régulation, ces intérêts déstabilisent les pêcheries artisanales moins prédatrices pour l’océan et contribuant aux approvisionnements alimentaires locaux, comme le long des côtes africaines. L’enjeu de la protection du puits de carbone océanique rejoint ainsi celui de la justice climatique, particulièrement dans les pays du Sud.
Sources / Notes
Le texte de cette contribution est extrait du chapitre 6 de l'ouvrage « Carbone fossile, carbone vivant intitulé » de Christian de Perthuis. Il est également disponible sur le site personnel de l'auteur accessible ici.
Les autres articles de Christian de Perthuis
TRIBUNE D'ACTUALITÉ
TRIBUNE D'ACTUALITÉ